Depuis 2016, la Réunion des musées métropolitains de Rouen organise, en partenariat avec la Fabrique de patrimoine en Normandie, l’Argument de Rouen, journée d’étude et de débat qui permet au public de rencontrer des professionnels de musées sur leurs actions. L’édition 2024, qui s’est tenue le 29 novembre au musée des Beaux-Arts de Rouen, portait sur les musées et la recherche de provenance. A cette occasion étaient réunis des professionnels de musées, des chercheurs indépendants, des universitaires et des représentants du ministère de la Culture.

La première table-ronde était consacrée à la politique nationale de la recherche de provenance avec trois représentants du ministère de la Culture. Adjointe au sous-directeur des collections du service des musées de France, Claire Chastanier a présenté les enjeux scientifiques, éthiques et juridiques de la recherche de provenance en rappelant son importance, tant pour la documentation des collections déjà présentes dans les musées, que pour les nouvelles acquisitions qui requièrent une vigilance de plus en plus accrue. Claire Chastanier a rappelé le nouvel appareil législatif permettant la sortie de biens culturels du domaine public : la loi relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites (1933-1945) du 22 juillet 2023, celle relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques du 26 décembre 2023 et la dernière loi en cours d’élaboration, dont le périmètre n’est pas encore définitivement établi. Catherine Chevillot, conservatrice générale du patrimoine, chargée de la préfiguration de la mission Provenance au service des musées de France, en a présenté les principales futures fonctions : coordination de la politique de recherche de provenance, animation du réseau, rôle de conseil. Catherine Chevillot a également annoncé la constitution de groupes de travail pour proposer aux musées de France une méthodologie commune, des outils de recherches, des lieux de ressources. David Zivie a, quant à lui, présenté les fonctions de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS) qu’il dirige au ministère de la Culture. La M2RS est chargée de piloter et d’animer la politique publique de recherche, de réparation et de mémoire des spoliations de biens culturels. Les recherches de la mission portent autant sur les biens MNR (Musées nationaux récupération) que sur les biens culturels entrés dans les collections publiques depuis 1933. En 2024, plusieurs musées ont bénéficié de missions d’expertise de leurs collections par des chercheuses indépendantes comme à Rouen, Angers, Paris, Strasbourg et en région Auvergne Rhône-Alpes. Ces missions sont encadrées par la M2RS et sont renouvelées en 2025.
La deuxième table-ronde de la journée portait sur l’actualité de la recherche de provenance dans les musées normands comme au château-musée de Dieppe, au musée des Beaux-Arts de Caen et celui de Rouen. Hélène Ivanoff, historienne indépendante, a présenté les deux missions menées au musée des Beaux-Arts de Rouen avec Marie Duflot et Denise Vernerey-Laplace en 2023 et 2024. La première mission avait pour objectif de faire un audit des collections en fonction des risques de spoliations afin de cibler un corpus d’œuvres qui devra faire l’objet de recherches plus approfondies. Sur les 20 000 items étudiés, une quarantaine d’œuvres ont été identifiées. Lors de la seconde mission en 2024, les recherches ont porté plus précisément sur les peintures acquises depuis 1933. Il est intéressant de noter que ces missions s’inscrivent dans une démarche globale puisqu’elles s’accompagnent d’un projet de publication et d’exposition, la participation à l’organisation de l’Argument de Rouen mais aussi l’élaboration d’un manuel de recherche de provenance à destination des équipes du musée. Hélène Ivanoff a conclu sa présentation sur l’importance de la coopération entre les équipes du musée et les chercheurs indépendants, mais aussi sur le besoin de coordination et de dialogue des missions menées dans les musées en région.
La troisième table-ronde de la journée était consacrée à des exemples concrets de recherches de provenance. Fanny Lebreton, chargée de l’histoire des collections et de la recherche de provenance au musée de la Musique à Paris, a présenté le renouvellement de la signalétique du musée dans le cadre d’un important projet de refonte de ses espaces d’exposition permanents, visant à développer un discours enrichi sur la provenance et l’histoire de ses collections. Cette volonté s’est traduite par un renouvellement des cartels qui intègrent un paragraphe sur la provenance de l’objet, des informations sur les anciens propriétaires ainsi que leur fonction et les modes de cessions. Lucile Paraponaris, chargée de recherches de provenance au musée de l’Armée à Paris, a présenté la politique de recherche de provenance mise en place au musée depuis cinq ans avant de revenir plus en détail sur les grandes étapes d’une recherche de provenance. Des inventaires et archives présents dans les musées, aux sources externes disponibles dans de nombreux centres d’archives, Lucile Paraponaris est revenu plus particulièrement sur le cas des biens culturels issus de contextes coloniaux. Nathalie Neumann, chercheuse de provenance au musée de la ville de Fulda en Allemagne, a présenté la mission qu’elle a menée en région Auvergne Rhône-Alpes aux côtés de Caroline Bakra et de Deborah Fest Kindler. Cette mission d’expertise regroupait cinq établissements : le musée du monastère royal de Brou, le musée des beaux-arts de Lyon ainsi que le musée des tissus et des arts décoratifs, le musée d’art de Grenoble, enfin, le musée d’art et d’archéologie de Valence. Le but de cette mission était d’identifier les possibles risques de spoliation sur les œuvres, classées après étude par code couleur (rouge, orange, jaune, vert). Sur les 3 300 œuvres étudiées, les chercheuses ont défini moins de 10% d’œuvres problématiques.
Deux ateliers ont conclu la journée : le premier portait sur la coopération entre musées et enseignement supérieur, notamment avec l’Institut catholique de Paris qui va créer un master dédié à la recherche de provenance sur son campus de Rouen. Le second atelier, animé par Marie Duflot (doctorante associée, Centre Georg Simmel/EHESS) et Denise Vernerey-Laplace (historienne indépendante et chercheuse associée, Centre Georg Simmel), portait sur les clés pour se lancer dans une recherche de provenance. Plusieurs questions ont été abordées, notamment celle de l’indépendance des chercheurs, la confidentialité et la publicité des résultats, l’importance de la coopération et la confiance entre chercheurs indépendants et équipes du musée. Denise Vernerey-Laplace a conclu sur l’importance de la transparence de la recherche ainsi que sur son indépendance, la collaboration et la neutralité.
Pour le programme complet de la journée, cliquez ici.
Image à la une: Capture d’écran de l’annonce sur le site web du musée des Beaux-Arts de Rouen.
Cet article est publié sous les conditions mentionnées dans notre clause de non-responsabilité / This article is published under the conditions expressed in our disclaimer.


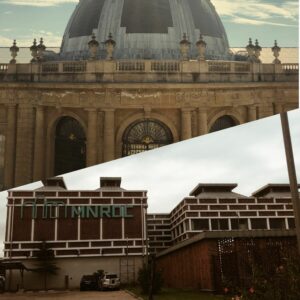

One thought on “Journée de débat – l’Argument de Rouen : Musées et recherche de provenance : où en est-on ?”
Comments are closed.